|
sommaire_biographies
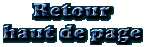
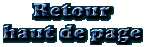
|
Pour la version
 de
ce document, de
ce document,
cliquez sur l'icône.
(recommandé pour imprimer ou partager par courriel)
|
LES PARENTS
DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
|
UN MODÈLE POUR TOUS LES PARENTS

Le 19 octobre prochain (2008) aura lieu, dans la
basilique de Lisieux, la béatification de Louis et
de Zélie Martin, les parents de Marie-Françoise
Thérèse Martin, connue pour l'éternité désormais
sous le nom de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ou
sainte Thérèse de Lisieux.
C'est la deuxième fois que l'Église béatifie un
couple marié. La première fois, c'était en 2001 avec
la béatification de Luigi et Maria Beltrame
Quattrochi, parents de quatre enfants : deux fils
devenus prêtres, une fille devenue religieuse et une
autre qui a vécu comme vierge consacrée.
Les époux Martin furent les parents de neuf
enfants, dont quatre moururent en bas âge. Sainte
Thérèse dira :
«Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus
dignes du Ciel que de la terre, ils demandèrent au
Seigneur de leur donner beaucoup d'enfants et de les
prendre pour Lui. Ce désir fut exaucé, quatre petits
anges s'envolèrent aux Cieux, et les cinq enfants
restés dans l'arène prirent Jésus pour Epoux.»
Les cinq filles de la famille Martin entrèrent
en effet au couvent et si l'une «revint dans le
monde», elle y vécut «comme étant dans le cloître».
Les parents Martin ont tous deux une grandeur
d'âme exceptionnelle et une foi admirable. Tous
deux, avant de se marier et avant de se connaître,
ont voulu se consacrer totalement à Dieu: lui en se
présentant au monastère du Grand-Saint-Bernard, elle
en demandant son admission chez les Sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul. Dans les deux cas, ce leur
fut refusé. Mais on comprendra que leur désir, non
exaucé, de vie religieuse leur ait fait comprendre
et accepter la vocation religieuse de leurs cinq
filles.
Le grand désir de perfection des époux Martin
fera aussi que, pendant neuf mois après leur
mariage, ils garderont une chasteté absolue. Puis,
sur «l'injonction d'un confesseur clairvoyant», ils
abandonneront cette voie très exceptionnelle. Là
aussi, on comprend que pour l'avoir pratiquée un
temps dans leur mariage, Louis et Zélie Martin ont
d'autant mieux accepté et compris la valeur de la
virginité perpétuelle vécue dans la vie religieuse.
L'Église, en offrant, aux fidèles, les époux
Martin en modèles, met donc à l'honneur les
aspirations à la vie religieuse (même quand elles
étaient trompeuses) et met à l'honneur la virginité
(même temporaire). Sans oublier la chasteté, car il
est vrai, comme l'a rappelé Jeanne Smits le 15 août
dernier, que c'est à la lumière du don total à Dieu
dans la virginité consacrée «que se mesure la
chasteté conjugale». Nos contemporains, aveuglés,
désensibilisés et bouleversés quotidiennement par
l'invasion pornographique, ont oublié le sens et la
valeur de la virginité et de la chasteté.
Est-ce à dire que la vie des époux Martin et de
leurs enfants fut, dans le siècle, comme celle d'une
famille au couvent? L'image, qui risque d'être
mièvre, est fausse. En devenant épouse puis mère de
famille, Zélie Martin n'a pas abandonné son métier
de dentellière, elle est restée à la tête d'une
petite entreprise de fabrication de la célèbre
«dentelle au point d'Alençon». Son mari va en
commercialiser la production, avec de fréquents
voyages à Paris.
Louis Martin, s'il va à la messe tous les matins
et s'il fait partie d'une Congrégation du
Saint-Sacrement, n'est pas comme un moine vivant
dans le siècle. Il aime la pêche, jouer au billard,
fabriquer son cidre, chanter des chansons pour ses
enfants. Il est aussi, ce qu'on appellerait
aujourd'hui, un «chrétien engagé». Il adhère à
l'œuvre des Cercles catholiques d'Albert de Mun et
de René de la Tour du Pin, il assiste aux
conférences qu'ils organisent, il est membre des
Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, il est abonné
à la Croix, il aime les pèlerinages (à Notre-Dame
des Victoires de Paris, à Chartres, à Lourdes), il
aime les retraites à la Trappe de Mortagne.
Zélie Martin, tertiaire franciscaine, est
active, spontanée, tandis que son mari est plus
silencieux et discret. Leur complémentarité fait
leur force et leur bonheur. Les épreuves, pourtant,
ne leur ont pas manqué. En 1877 (la future Thérèse
de l'Enfant-Jésus avait quatre ans et demi), Zélie
Martin meurt d'un cancer du sein. Louis Martin,
atteint d'une artériosclérose cérébrale à la fin des
années 1880 (ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie
d'Alzheimer), devra être interné durant trois ans.
Par ces épreuves, la famille Martin est proche
des épreuves physiques et morales que connaissent
toutes les familles, conséquence de la finitude de
notre existence sur terre. Zélie puis Louis Martin,
comme leurs filles, les ont vécues ni dans la
révolte contre Dieu ni dans la résignation mais dans
une vision surnaturelle de l'existence où le
chrétien sait que cette terre, périssable, n'est pas
le terme de son chemin.
Le docteur Robert Cadéot, lecteur de Présent de
la première heure, a publié la biographie de Louis
Martin en 1985 et celle de Zélie Martin en 1990 (les
deux ouvrages ont été réédités en 1996 aux éditions
François-Xavier de Guibert). On lira aussi avec
intérêt et admiration les lettres de Zélie et de
Louis Martin, Correspondance familiale. 1863-1885,
Cerf, 2004.
YVES CHIRON
Article extrait du no.
6658
du Journal Présent
du samedi 23 août 2008
|
www.revueenroute.jeminforme.org
Site produit par la revue "En Route".
Autorisation de diffuser ce document, avec mention de la source.
|
|